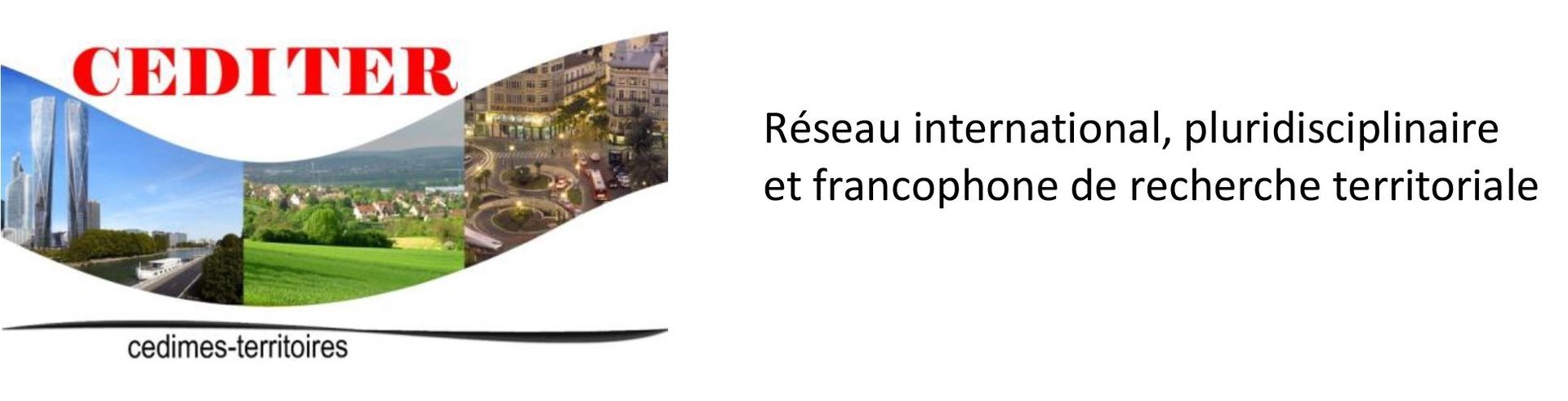Les communications faites par Nadia CHETTAB
Année 2024
L'histoire de la prospective en Algérie (histoires d'aventures prospectives - JFD éditions)
L'article convie aux racines de l'histoire contemporaine de l'Algérie pour réfléchir conjointement aux possibilités d'émergence d'une démarche de prospective ouverte et inspirante dans ce pays. L'attention se porte sur l'ensemble des parties prenantes du pays, tout particulièrement sur les jeunes. Le contexte est marqué par les choix antérieurs d'un développement économique et social fondé essentiellement sur la rente pétrolière. Le texte insiste sur le fait que, si si cette rente fut une très grande chance pour l'Algérie, elle a aussi créé une grande entrave au développement du pays, à savoir l'absence de développement d'une activité économique nationale plus diversifiée et au bénéfice de toute la population. En conclusion, il est proposé une vision économique et sociale plus large et intégrative pour le pays. L'espoir est de créer une communauté de volontés, d'expertises et d'intelligences qui permettent de se projeter vers l'avenir pour le mieux de toutes et de tous.
Année 2023
(Re)Penser l’avenir des tiers lieux (cahiers du CEDIMES 2023/3 - page 125 et suiv.)
La pandémie du Covid 19 a accentué les mouvements entropiques socio-politiques et économiques : les règles, les critères, les normes ont été remis en question à tous les niveaux (macroéconomique, microéconomique et méso-économique). Ces bouleversements inédits ont mis en exergue de nouvelles manières de faire et de (re)penser l’avenir des tiers lieux pour (re)faire système. L’examen du présent montre la nécessité et l’urgence de penser, aujourd’hui, les conditions et les dispositifs à mettre en place sur nos territoires pour asseoir « l'économie de la vie » sur des processus productifs complets.
Mots clés : Tiers lieux, Territoire, Prospective, Processus productifs complets
Année 2021
Les mouvements des communs, un monde au-delà du marché et de l’Etat (Rencontres 2020 du CEDITER - cahiers du CEDIMES n° 4/2021 - page 183 et suiv.)
En cette période de crise, de nombreuses initiatives portées par les mouvements de l’open (source/ innovation /hardware/Data) ont émergé pour répondre aux besoins et aux enjeux sociaux et sanitaires actuels. Les usagers des fab-labs et les makers ont été les premiers à se mobiliser pour aider les personnels soignants à faire leur travail dans de bonnes conditions. Puis s’en est suivi un mouvement mettant en pool commun les ressources de la connaissance qui ont démontré leur « Powerment » (capacité de contribuer) en proposant plusieurs projets innovants ( notamment les moyens de protection anti-Covid sous licence Creative Commons etc.) pour solutionner des problèmes locaux tout en procédant à l’essaimage de ces solutions à l’échelle mondiale (telle l’ouverture des brevets par les fabricants de respirateurs Medtronic) grâce à une logique d’ouverture basée sur le partage des données et de la documentation (open Science/Data). Ces mouvements des communs ont transformé, à la fois, les pratiques sociales et politiques mais, également, les aspects juridiques de la propriété intellectuelle. Ils permettent surtout d’envisager le partenariat « Public-Privé-Commun » comme un horizon politique prometteur en ces temps de crises économique et sanitaire. Le but de notre communication est de comprendre l’origine et le développement de ces initiatives, souvent complémentaires et parfois alternatives aux dispositifs publics et dont la finalité est l’utilité sociale, mais aussi, de montrer comment elles se sont imposées comme formes possibles d’organisation des rapports dans un système économique, longtemps, dominé par le duo « État-Marché ».
Mots clés :
Les communs numériques, les mouvements des communs, les Fab-labs et le territoire.
Année 2020
(Rencontres 2018 du CEDITER - cahiers du CEDIMES n° 1/2020 - page 181 et suiv.)
L’innovation ouverte, avec la quatrième révolution industrielle comme catalyseur, restructure le monde sur de nouvelles valeurs et les réponses apportées par les pouvoirs publics aux mutations économiques et à leurs effets sont appréhendées comme des facteurs favorisant la transition systémique des territoires vers le numérique pour faire émerger des avantages dynamiques dans des secteurs industriels à hautes valeurs ajoutées. La territorialisation de la politique industrielle s'est alors progressivement affirmée comme un facteur critique de la croissance économique notamment avec l'émergence des thèses de la théorie institutionnelle comme un cadre majeur d'explication et de proposition.
Le but du présent travail est de cerner le mode et la nature du processus de croissance et de développement industriel, et la place majeure qu'occupe le facteur institutionnel à l’ère de l’innovation ouverte et du numérique.
Mots clés :
Institution, déconcentration, décentralisation, démocratie participative et gouvernance multiscalaire.